“L’industrie de l’aide” entrave l’émancipation
L’universitaire Firoze Manji, livre à Basta ! son analyse sur la renaissance des mouvements populaires africains. Ses critiques visent « l’industrie de l’aide », qui entrave la réappropriation par les Africains de leur continent.
Présent au Forum social mondial de Dakar, l’universitaire kenyan, Firoze Manji, livre à Basta ! son analyse sur la renaissance des mouvements populaires africains. Dentiste à l’origine, Firoze Manji a travaillé avec plusieurs organisations non gouvernementales et fondations. Il est aujourd’hui chercheur associé à l’université d’Oxford (Royaume-Uni). Il édite depuis 2001 un site d’informations altermondialiste africain, pambazuka.org. Ses critiques visent « l’industrie de l’aide », qui entrave la réappropriation par les Africains de leur continent, gangrené par la corruption et le pillage des richesses.
Firoze Manji : En Afrique, deux sortes de sociétés civiles ont existé historiquement : celles qui ont collaboré avec le pouvoir colonial et celles qui s’y sont opposées. Aujourd’hui nous connaissons la même situation : il y a celles qui s’associent à l’industrie de l’aide, qui en bénéficient et recourent au langage du développement. Et celles qui parlent d’émancipation. Il y a bien sûr beaucoup de nuances entre ces deux groupes, entre ceux qui travaillent dans une vision de développement charitable et ceux qui œuvrent à l’émancipation des Africains. En général, les organisations locales, les syndicats, les mouvements paysans, parce qu’ils ont un intérêt direct dans leur propre liberté, ont une dynamique très différente de ceux qui participent à l’industrie de l’aide.
Ne parlons pas de leurs motivations, qui sont très souvent bonnes. La question n’est pas d’évaluer leurs intentions, mais plutôt les conséquences réelles de leurs actions. Dans une situation politique où les gens sont opprimés, une organisation humanitaire ne fait qu’adoucir la situation, sans que cela ne règle le problème. Si vous regardez cela dans une perspective historique, nombre d’ONG participent inconsciemment à la situation d’oppression. Vous pouvez y voir des similarités avec la France occupée. Des gens bien intentionnés ont objectivement participé au régime de Vichy. Entre la collaboration active et la résistance, il existait un large spectre de possibilités. Nous trouvons la même situation en Afrique aujourd’hui.
Qui va changer le monde ? Les citoyens africains ou des organisations paternalistes ? Et selon quels intérêts ? Faisons un parallèle avec le mouvement féministe. Il est né parce que les femmes revendiquaient leurs propres outils de lutte. Elles n’ont pas fait appel aux hommes pour résoudre le problème à leur place. C’est pareil pour les Africains. Nous ne pouvons pas dépendre des autres. Les fermiers, les ouvriers doivent être capables de s’organiser. Quand on regarde l’extraordinaire étendue des richesses en Afrique, l’un des continents les plus riches du monde, pourquoi est-ce celui qui abrite la population la plus pauvre ? Notre rôle, en tant que membre de la société civile qui avons bénéficié du privilège de recevoir une éducation, est de combattre cette situation.
Je suis devenu anti-développement. Ce n’était pas le cas avant. Faisons une analogie : les esclaves avaient-ils besoin de se développer, ou de s’émanciper ? Je pense que nous avons besoin d’émancipation, pas de développement. Ce concept a été créé au début des années 1950 dans un rapport du département d’État américain. Il a été inventé comme un contrepoint aux influences socialistes et à leur popularité. Cela s’est fait consciemment. Parler de développement est apolitique. Nous devons re-politiser la question de la pauvreté.
Nous traitons avec un système impérialiste, une nouvelle forme de colonialisme. Ces vingt dernières années nous faisons face à un changement majeur : la financiarisation du capitalisme. Personne ne peut plus rien faire sans capital. La finance contrôle tous les secteurs de la société. Il est effectivement temps de se demander qui sont les maîtres. Poser cette question il y a dix ans signifiait se faire traiter de fou. Aujourd’hui, c’est devenu légitime. Il existe différentes interprétations, mais plus personne en Afrique ne proclame que nous sommes indépendants. Même pas la classe dirigeante.
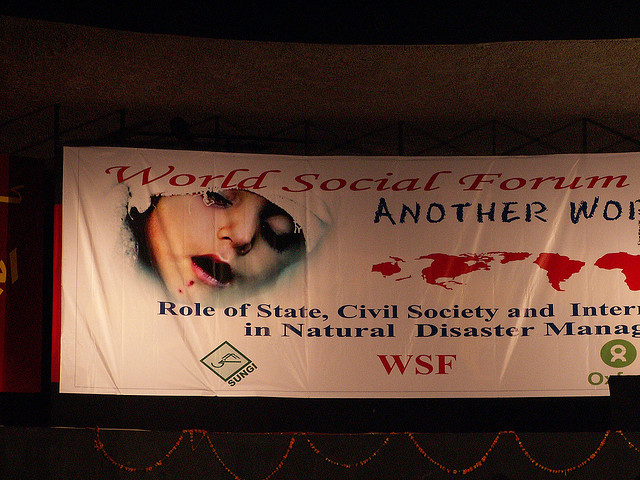
Au sein des États issus des indépendances, les nouvelles classes dirigeantes se sont déclarées seules responsables du développement. Au Kenya par exemple, les syndicats de paysans ont été fermés et intégrés dans un parti politique, idem pour les mouvements de femmes. Puis les partis politiques eux-mêmes ont été fermés pour ne créer que le parti d’État. Immédiatement après l’indépendance du Kenya (1963), beaucoup d’acteurs importants de la libération ont été emprisonnés, exilés ou tués, de même que Patrice Lumumba au Congo ou Thomas Sankara au Burkina Faso. Chaque fois qu’un leader a eu le courage de se rebeller, l’Europe et les États-Unis l’ont forcé à baisser la tête. Nous avons connu une période de vide jusqu’au milieu des années 1990 où les gens ont recommencé à résister et à s’organiser. Aujourd’hui au Kenya, les espaces de discussions et de débats ne manquent pas. C’est vibrant, vivant, et c’est une tendance générale. Y compris en Europe.
Les gens s’interrogent de plus en plus, se révoltent. En Grande-Bretagne, on se demande pourquoi toujours davantage d’argent est donné aux banques alors que des hôpitaux et des écoles ferment. Le nombre de gens engagés dans l’analyse et la critique progressent largement. Quelque chose de nouveau apparaît. On voit une résurgence d’actions. Bien sûr l’activisme n’est pas suffisant. Le problème que nous rencontrons au Kenya est que le capitalisme est perçu, malgré tout, comme la seule alternative. On essaie donc de l’améliorer. Alors que le capitalisme est terrifiant en soi. Les faits parlent d’eux-mêmes : l’énorme accaparement des terres, le chômage, l’appauvrissement, la mortalité infantile qui augmente, le prix de la nourriture qui monte… Dans moins de 10 ans, plus de la moitié de la population vivra autour des villes, essayant de survivre. Le questionnement actuel ne change rien à la situation, mais c’est un bon début !
Les nouvelles technologies permettent bien sûr de communiquer et de s’organiser, mais n’oublions pas que ce sont les gens qui le font. Regardez la Tunisie : on entend que cette révolution a été causée par Twitter… Ce n’est pas sérieux ! Des stylos aussi ont été utilisés comme moyen d’information et de mobilisation. Est-ce que cela signifie que les stylos ont permis la révolution ? Cela révèle une tendance au déterminisme technologique, au fétichisme high-tech. On imagine que les portables, les SMS, Twitter, Facebook ont un pouvoir. Ce genre de discours tend à sous-estimer le rôle de ceux qui l’utilisent. En Tunisie, manifester dans la rue demande beaucoup de courage. Un manifestant qui embrasse un soldat, comme on le voit sur une photo, n’est pas déterminé par la technologie. J’ai beaucoup travaillé sur l’utilisation des téléphones portables. On croit que cela peut tout résoudre mais un tiers des Africains en possède un et il n’y a pas de révolution partout.
Prenez par exemple l’agriculture : la plupart de ce qui est produit en Afrique est destinée à nourrir l’Europe, les multinationales, les supermarchés. Au Kenya nous produisons des millions de fleurs. Tous les jours, elles partent vers Amsterdam. La quantité d’eau et de produits chimiques utilisés détruit notre environnement. Pendant ce temps, les populations ont des difficultés d’accès à l’eau et à l’alimentation. Les champs pourraient servir à produire de la nourriture ! La question est : qui décide ? Pouvons-nous démocratiser la décision de ce qui est produit, comment cela est produit et pour qui ? Il n’y a ni procédure, ni structure de décision, il n’y a même pas de débat à ce propos. Juste une élite qui décide et décrète des subventions pour le faire. Qui devrait décider de ce qui est cultivé et de comment le cultiver ? Il faut démocratiser le processus de production agricole.
C’est la même chose pour la production industrielle. Regardez les incroyables ressources naturelles africaines : pourquoi les Africains n’en bénéficient pas ? J’ai discuté avec des Vénézuéliens. Ils nous ont dit avoir un grand pouvoir de négociation grâce à leur production pétrolière. En Afrique, nous avons du pétrole alors pourquoi nous n’avons aucun pouvoir de négociation ? C’est principalement une question politique. Je pense que l’Amérique latine est en avance d’une dizaine d’année sur nous. Les politiques d’ajustements structurels y ont commencé depuis deux décennies. Je pense qu’en Afrique, un mouvement populaire surgira d’ici à 2020. Chavez n’est pas exceptionnel, il est le produit de son histoire, du mouvement d’émancipation tout comme Lula. La question est : comment peut-on nous aussi politiser ce processus ? Ce n’est pas facile, il n’y a pas de solution technique. Il faut que les travailleurs et les fermiers s’organisent. Cela prend du temps. Le point positif c’est, qu’aujourd’hui, cette question est débattue, ce qui n’était pas le cas il y a 10 ans.
Cela peut aller dans toutes les directions. Après la crise de 1929, une crise de confiance a traversé l’Europe, et l’Allemagne est partie dans le mauvais sens. La crise de confiance est une part nécessaire du processus mais ce n’est pas suffisant. Avec le discrédit porté sur le stalinisme, c’est tout le concept de socialisme qui n’est plus attirant, nous devons donc créer une nouvelle idéologie, de nouvelles aspirations. Si cela ne se produit pas nous entrerons dans une phase très dangereuse. Sans alternative viable, n’importe qui pourra prendre l’avantage. C’est en même temps une situation terrifiante et pleine d’espoir.
Recueilli par Ivan du Roy et Jennifer Austruy (Basta ! en partenariat avec Politis)
—
Article initialement publié sur Basta !

Laisser un commentaire