La presse écrite se meurt, vive l’information par l’écrit !
Régis Confavreux a dirigé deux grands titres nationaux. Il nous livre ici sa grille de lecture de la crise qui secoue la presse écrite et ébauche des solutions.
Il y a près de deux ans, le 2 octobre 2008, Nicolas Sarkozy inaugurait les États généraux de la presse écrite. Rappelant aux acteurs de l’information présents ce jour là à l’Élysée que l’État consacrait plus d’un milliard d’euros [la réalité étant plus proche de 1,5 milliards] chaque année à ce secteur économique, soit environ 10% de son chiffre d’affaires, le chef de l’État soulignait que « l’avenir de la presse relève en grande partie de votre responsabilité. Vos difficultés ne trouveront aucune solution si vous restez divisés (…) ».
Ces mots sont restés sans écho. Et si les États Généraux ont accouché de nombreuses mesures, elles sont à l’image de la profession puisque préconisées par elle : une pharmacopée budgétaire et technique certes indispensable, mais qui conforte la Presse écrite dans son image de corps malade et sous assistance… Jusqu’aux prochaines élections présidentielles, sans avoir eu à se pencher, du fait de ses propres divisions, sur ses responsabilités.
La Presse divisée
La Presse est un des rares secteurs de l’économie française divisée en une vingtaine de syndicats, dont sept principaux (deux pour la presse magazine et cinq pour la presse quotidienne), pour se limiter à la presse « papier ». Cette situation est hautement préjudiciable. Non seulement la Presse investit lourdement dans des structures qui stigmatisent ses propres divisions, mais en plus, elle permet à ses interlocuteurs – l’État, Google, les annonceurs – de mener le jeu.
Le discours inaugural de Nicolas Sarkozy énumère en filigrane les enjeux principaux sur lesquels les Éditeurs devraient s’unir et réfléchir ensemble. Plutôt de que de laisser un système d’imprimerie peu efficace et onéreux perdurer, la Presse quotidienne ne devrait-elle pas sortir du système d’organisation du travail dominé par le Syndicat du Livre par la voie de la négociation et en mutualisant ses moyens financiers et humains ? On l’a vu dans d’autres secteurs (la manutention portuaire par exemple), l’État est là pour accompagner ces mouvements de modernisation, dès lors qu’ils dénotent un esprit de responsabilité aujourd’hui difficile à déceler.
Et que dire de la distribution de la presse : plusieurs réseaux de distribution coexistent dans une ignorance mutuelle, hormis quelques initiatives récentes et limitées: le réseau postal pour la distribution de la presse à ses abonnés ; le réseau des Messageries pour le service de la Presse à ses acheteurs en kiosques, lui-même scindé entre les NMPP et les MLP, qui se font la guerre plus qu’ils n’optimisent leurs services ; et les réseaux de portage, propriétés privées de la Presse Quotidienne Régionale pour l’essentiel, qui se substituent à la distribution postale et se développent en ce moment même avec l’aide financière renforcée de l’État (78 millions d’euros par an). Même si les mentalités changent peu à peu, le discours dominant est qu’il n’y a pas, ou peu, de mutualisation de réseau à espérer ; et au-delà, qu’une politique de gestion de réseau désormais entrée dans les mœurs ailleurs (transports ferroviaires, réseaux énergétiques par exemple), fondée sur le principe de la séparation de gestion des infrastructures et de la gestion des flux, ne serait pas applicable à la distribution de la presse.
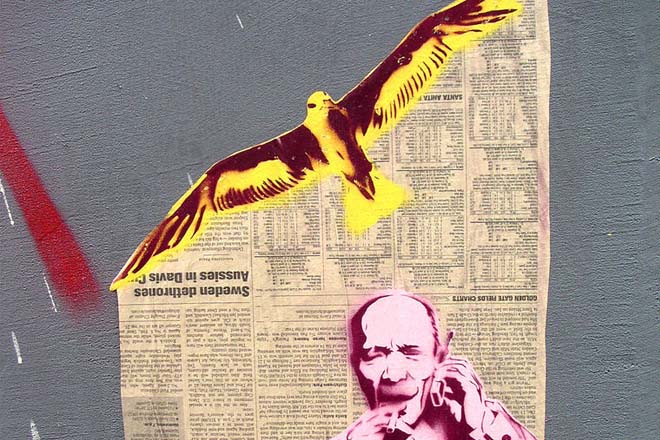
La Presse reste enfin profondément corporatiste. A cet égard, les conclusions des États Généraux de la Presse sur le métier de journalisme sont essentiellement conservatrices, allant jusqu’à officiellement demander de préserver les clauses de conscience et de cession – qui permettent à tout journaliste, du correcteur au directeur de la rédaction, de quitter l’entreprise avec des indemnités de licenciement (1 mois de salaire pour les 15 premières années d’ancienneté, le surplus faisant l’objet d’un arbitrage souvent plus favorable encore au salarié) en cas de changement de « ligne éditoriale » (concept par ailleurs non défini) ou de capital de l’entreprise.
Si une « révolution professionnelle » était en cours, la Presse pourrait s’intéresser à des questions stratégiques : comment informer dans un monde multimedia et interactif ? Un journaliste de la « Presse» va-t-il se mettre à créer efficacement du son et de l’image à coup de quelques formations professionnelles ? Ne faudrait-il pas songer à rapprocher les médias – radio, TV, écrit – pour que les excellences, au lieu d’être soigneusement jalouses les unes des autres au contraire coopèrent et se syndiquent (au sens anglais du terme) pour satisfaire les attentes des citoyens ? Comment mieux maitriser les relations avec les moteurs de recherche, plutôt que de subir ? Pourquoi ne pas s’unir pour développer de nouveaux services digitaux ? La liste est longue.
La Presse victime d’elle-même
La crise de la Presse est bien antérieure, on le sait, à la crise financière globale de 2008. Traditionnellement financée par sa diffusion, mais aussi et majoritairement par la publicité et par l’État, bénéficiant de son statut de gardien de la démocratie, tout lui parait permis, et en toute impunité par rapport aux contraintes économiques. Assez tôt, une partie de la profession a cru tirer avantage à diffuser « gratuitement » – c’est-à-dire avec des coûts mais sans recette de diffusion – qui des programmes TV, qui des suppléments de fin de semaine, ou qui des petites annonces. C’était le premier aveu du peu de considération que l’Éditeur se fait de ses propres contenus. Ce modèle longtemps marginal a fait une percée fulgurante à l’aube du XXIe siècle avec les quotidiens gratuits.
Ce modèle a été considérablement renforcé par l’émergence de l’Internet, qui a donné naissance au mythe, cette fois-ci, du « tout » gratuit. En particulier sous la pressions des régies publicitaires est née l’idée d’une « économie Internet » différente de l’économie «classique» et croyant pouvoir s’affranchir des règles de cette dernière, puisque fondée sur l’échange et le gratuit – ce qui en effet est antinomique avec les modèles dits classiques.
La Presse se lance alors dans une course à l’audience, toujours jugée décevante par les annonceurs et les régies publicitaires. Dans cette course, les Éditeurs s’essoufflent et tombent à genoux devant Google pour que leurs contenus apparaissent, contre rémunération, dans le moteur de recherche : c’est ce qu’on appelle pudiquement le « référencement », système par lequel le moteur va mettre en avant tel contenu sur tel sujet, et d’autant plus visiblement qu’il est plus consulté par les internautes.

Aujourd’hui, un Éditeur non référencé par Google est un Éditeur réputé invisible sur la Toile. En revanche, un Éditeur de presse bien référencé peut rêver d’une audience en croissance asymptotique. Dans ce marathon épuisant, c’est en premier Google qui augmente son audience, et ce faisant, met la main sur la moitié du marché publicitaire numérique mondial. Les diffusions payantes plongent ? La solution envisagée est ensuite la vente à l’acte des articles… par Google ! En résumé, les éditeurs de presse donnent leurs contenus à un organisme qu’ils paient pour les diffuser gratuitement et à qui ils s’apprêtent à confier leur diffusion payante. Cela ne suffit pas ? Aujourd’hui Google annonce être en mesure de sauver la Presse.
Au–delà des aspects financiers, le référencement fonctionne par mot-clés à faire apparaitre dans les titres et sous-titres. Dès lors, les articles des différents organes de presse sont rédigés avec les mêmes mots, destinés à satisfaire l’objectif de remontée optimale dans les moteurs de recherche. Adieu les idées, les opinions et les titres bien sentis : tous sont sacrifiés sur l’autel du conformisme au nom du référencement et d’audiences aux limites toujours fuyantes.
La Boétie comme source de réflexions ?
Les professionnels qui ont développé avec Google (et aussi avec l’État, tout au moins en France) ce qui ressemble fort à un syndrome de Stockholm pourraient relire ou lire le « Discours de la servitude volontaire » d’Étienne de La Boétie :
« Ce tyran seul, il n’est pas besoin de le combattre, ni de l’abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s’agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. »
Et de fait, Google n’a aucun journaliste et aucun savoir-faire dans le traitement de l’information, il n’a que ce que les Éditeurs, sermonnés par les régies publicitaires, lui donnent, voire lui « achètent », ici entendu comme : donner ses biens (effet servitude volontaire) et au surplus le payer pour cela (effet syndrome de Stockholm) .
Mais maintenant qu’il lui a été beaucoup donné, que faire ? Le pronostic de La Boétie est sombre : « j’admets [que l’homme] aime mieux je ne sais quelle assurance de vivre misérablement qu’un espoir douteux de vivre comme il l’entend ». Ah… Il ne reste donc qu’à savoir qui sera le tyran naissant des cendres de nos phénix :
- Soit un agrégrateur de type Google : mais « plus les tyrans pillent, plus ils exigent ». La prochaine étape serait donc l’installation de Google Inc à l’étage de direction de nos entreprises de presse (directions de la rédaction et directions générales).
- Soit un agrégateur d’un autre type, né de l’union des médias – pas seulement de l’écrit – actuels ou nouveaux entrants, pour faire démentir La Boétie.
Il serait logique que le gagnant soit celui qui détienne le savoir-faire. Le marché de l’information a besoin d’acteurs puissants, prêts à cesser de donner pour survivre et à même de faire respecter les règles de concurrence saine et loyale sur ce marché. C’est ici que la problématique de l’union professionnelle revient en question, et c’est ici aussi que se pose la question de l’influence de l’État sur le marché de la presse via les aides. Des aides dont les effets structurants pour l’avenir des métiers de l’information devraient être examinés ; et dont les distorsions en termes de concurrence devraient être analysées.
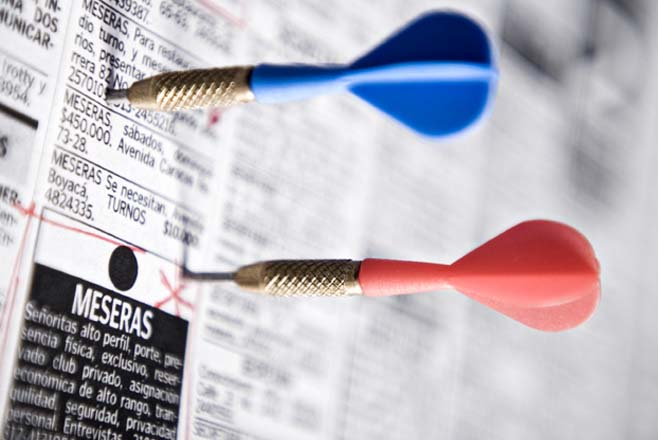
Se prendre en charge, mais comment ?
Le modèle « avant 2008 » de la Presse touche à sa fin. La gratuité – ou plus justement, le cycle de destruction de valeur – couplée à une incapacité à moderniser ses méthodes de production et de distribution pour améliorer de façon drastique sa productivité, ne permet plus de prétendre se développer sans changer de modèle économique. C’est ce nouveau modèle économique qu’il faut refonder – il ne s’agit pas tenter trouver un modèle économique de l’Internet. Ce nouveau modèle ne peut passer que par une remise en cause professionnelle, qui touche à la façon de produire, d’imprimer et de diffuser physiquement ou digitalement du contenu de qualité, c’est-à-dire un contenu qui ait une valeur intellectuelle et monétaire aux yeux des lecteurs.
Arrêter d’appauvrir les rédactions, et investir dans la qualité du contenu ; cesser les querelles de famille et s’unir, tant sur le plan professionnel qu’industriel pour être en mesure de discuter à part égale avec les interlocuteurs – publicitaires, moteurs de recherches – des médias , voici en deux phrases condensées ce qu’il faudrait viser, mais qui implique une véritable révolution des processus de production de l’information écrite. Encore plus brièvement exprimé, moins de dépendance et plus d’initiative. Alors, nous pourrons oublier les sombres anticipations de La Boétie.
__
Crédits Photo CC Flickr : Sicoactiva, Xanxhor, Iboy_Daniel, Otherthings.

Laisser un commentaire